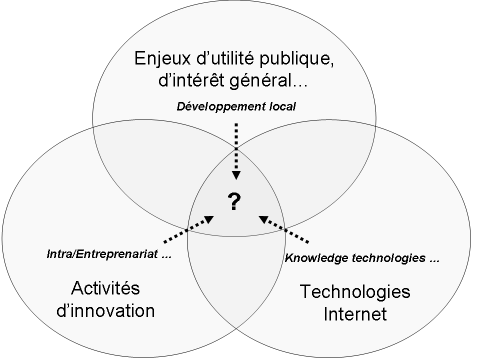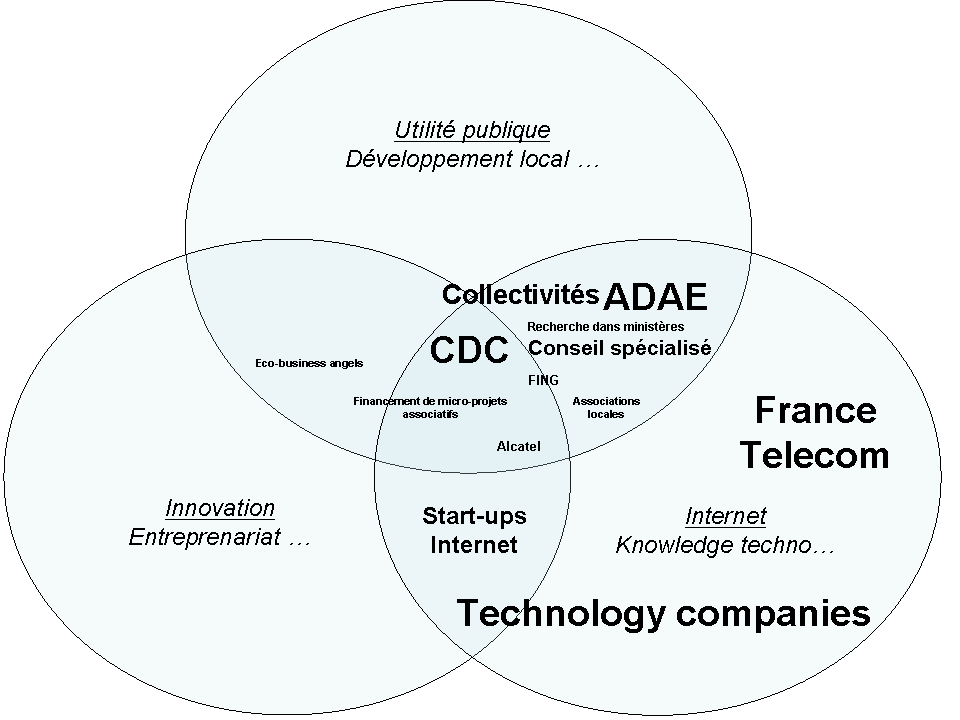Cet été, j’ai exploré avec plusieurs d’entre vous la jungle de l’innovation, de l’Internet et des projets d’utilité publique. A l’intersection de ces trois domaines, mon expédition visait à identifier des innovations Internet répondant à des enjeux d’utilité publique.
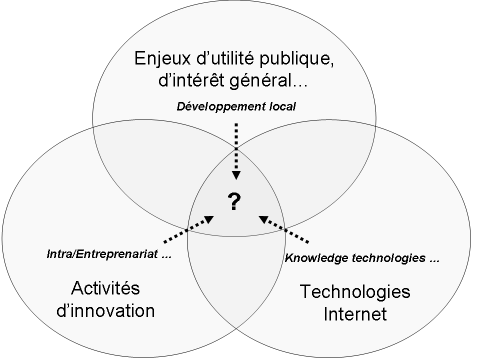
Avant de vous raconter cette expérience et de vous inviter à la poursuivre via ce blog, laissez-moi vous dresser le tableau avec quelques définitions préalables :
- Innovation : cf. qu’est-ce que l’innovation ? pour ma compréhension du sujet ; l’innovation relève pour moi d’une démarche de recherche entreprenariale.
- Internet : pas de doute, on sait ce que c’est ; mais pour être plus précis, mon intérêt est centré sur les technologies de gestion/traitement des connaissances issues de l’Internet (web sémantique, data mining, personnalisation, technologies pour le knowledge management) et les technologies Internet de mise en relation (social software), bref partout où il y a du lien, de la complexité et des réseaux relationnels (entre concepts, personnes, objets)
- Enjeux d’utilité publique, intérêt général : le champ est large et couvre aussi bien le monde associatif, le secteur public et l’économie sociale que des services Internet dont on aurait aujourd’hui du mal à se passer (Google est-il devenu un service d’utilité publique ?) ; mon intérêt est plus particulièrement centré sur le développement local.
Cet été, j’ai donc profité de quelques semaines de mes vacances pour explorer cette terra incognita, avec certaines questions en tête. Peut-on profiter des techniques issues de l’Internet pour changer de manière durable (innover) la société (utilité publique) ? Qui en parle et qui en fait ? Que faire (en tant que bénévole ou professionnel) pour contribuer à de telles innovations ? De rencontre en recontre, les questions se sont accumulées : les “innovations Internet d’utilité publique” (IIUP pour les intimes), est-ce que ça existe vraiment ? IIUP = OVNI ? qu’est-ce que c’est précisément ? On trouve assez facilement des exemples d’IIUP relevant de bricolages bénévoles de haute qualité mais cantonnés au monde du bénévolat et de l’amateurisme à petite échelle ; peut-on faire de l’innovation Internet d’utilité publique à grande échelle et avec des moyens vraiment conséquents ?
Voici donc le récit de nos rencontres (je change vos prénoms par anonymat de politesse…).
Chez un gros éditeur logiciel américain, Benoît, directeur commercial a la gentillesse de me recevoir. C’est l’un de mes anciens fournisseurs, avec qui je garde un bon contact. Bon, franchement, les IIUPs, ça le laisse un peu sec. Mais pour lui, pas de doute, il faut regarder du côté de l’Agence pour le Développement de l’Administration Electronique afin de repérer des projets innovants de grande ampleur. La Feuille d’impôt via Internet change-t-elle la société ? Mmm… Benoît m’avoue que, franchement, lui ne se voit que comme un vendeur de plomberie. A la limite, ce pourrait être ses clients qui pourraient faire des choses innovantes avec les logiciels qu’il leur vend. Il pense que l’un de ses collègues pourra peut-être me donner des pistes plus précises car il vend pas mal auprès du secteur public.
La jungle semble bien inextricable dans la région du commerce informatique professionnel : de la techno, certes mais peu ou pas d’innovation et, comme on peut s’y attendre, une absence totale d’utilité publique. Je dois mieux cibler mon approche.
Jean-Louis, vieux loup de l’associatif et du développement local et directeur d’un cabinet de conseil en conduite du changement, me reçoit avec sa générosité habituelle et m’invite dans sa brasserie préférée. Miam. Ma démarche le déconcerte peut-être un peu mais qu’à cela ne tienne, il m’accorde une attention toute perspicace. Il me parle des tentatives d’une grosse ONG française pour approcher les grandes entreprises sur des projets de type IIUP. Il me parle aussi du projet Digital Bridge d’Alcatel. Mais il me met également en garde contre l’auto-enfermement qui me guette si je me concentre sur la techno et les théories plutôt que sur la richesse de mon prochain, contre le mirage de la toute-puissante technologie qui cache l’homme et contre la méfiance voire le dégoût que la plupart des vieux loups du monde associatif conservent vis-à-vis de l’économique et du monde de l’entreprise. Pour me préserver de perdre contact avec mon prochain, il me prescrit la lecture de Simone Weil. Pour poursuivre mon exploration et découvrir des IIUPs, il me recommande de suivre la piste de la (petite) équipe Digital Bridge d’Alcatel.
Je ne suis pas encore passé à la pharmacie bibliothèque mais j’ai déjà compris que je tenais avec Alcatel une piste fragile mais prometteuse. Y a-t-il quelqu’un d’Alcatel dans la salle ? Poursuivons notre exploration.
Philippe est un entrepreneur aguerri dans le terrain du knowledge management. Innovation et KM ça le connaît. En plus, il a des projets plein la tête. Distribuer de la connaissance médicale “prête à l’emploi” à des médecins africains, ça fait longtemps qu’il y pense et qu’il s’y prépare ! Problème… Philippe est préoccupé par de gros soucis avec ses nouveaux associés.
Ce n’est pas le moment pour explorer avec lui plus avant la jungle des IIUPs. Il faut d’abord qu’il se rassure sur son gagne-pain. Ce n’est que partie remise.
J’avais rencontré Daniel dans un cadre associatif. Elu local en province, c’est par téléphone que nous nous entretenons. Il maîtrise parfaitement le sujet des projets coopératifs d’innovation locale grâce aux technologies Internet. Mais la dimension entreprenariale des innovations Internet d’Utilité Publique lui est étrangère. Pas de doute pour lui, l’intersection de l’utilité publique et de la technologie Internet grouille d’initiatives associatives locales, fourmille de projets d’espaces publics numériques, de sites Web citoyens, d’îles sans fils. Mais de là à parler de démarche économique ou de social entrepreneurship, c’est un pas que nous ne franchirons pas ensemble par téléphone. Pour lui, la bonne piste à suivre (si piste il y a), c’est sans doute celle de la FING. Ou peut-être à la limite de France Telecom, mais bon… avec peu d’espoir de succès.
Mmm… La FING, bien sûr, c’est facile. France Telecom, ça m’étonnerait, mais il faudra bien de toute manière explorer cette piste confuse, trompeuse et difficile. Mais par où la commencer.
A la FING, c’est naturellement vers Fabien que je me tourne. Fabien est une sorte de consultant comme on en recontre peu. Il connaît l’économie sociale comme sa poche. Il maîtrise l’Internet comme pas deux. Et les innovateurs, c’est son coeur de métier. Pour couronner le tout, c’est un copain à moi. Bref, l’interlocuteur idéal. Les Innovations Internet d’Utilité Publique, il en rêve. Il regrette les faibles moyens qui sont mobilisés sur ce sujet. Il n’est pas encore très au fait de la mode américaine du social entrepreneurship : mettre la force économique au service d’innovations d’intérêt général. Sans parler d’économie de communion. Mais il pense que c’est une piste qui a du sens. Peut-être ne découvrirais-je pas d’Eldorado des IIUPs mais ça ne l’étonnerait pas qu’un jour… quelqu’un comme vous, lui ou moi contribue à en construire. Il m’aide donc à cibler au mieux la poursuite de mon exploration, me suggère de vous raconter toutes mes découvertes sur mon blog et m’ouvre tout son carnet d’adresse (qui est sans fond, j’en témoigne).
Il m’introduit notamment auprès de son boss, Daniel et auprès de Claude (France Télécom). Il me semble qu’on avance ! Merci !
Daniel, consultant expérimenté en innovation publique et grand chef de la FING, se révèle également d’une grande sensibilité à l’intérêt de ma quête des IIUPs. Il y contribue à son tour en me recommandant auprès de responsables de l’innovation de plusieurs de nos vénérables institutions publiques françaises. Pour lui, les acteurs les mieux placés pour mener des IIUPs sont sans aucun doute les collectivités territoriales. L’Etat a-t-il encore vraiment les moyens de mener de telles innovations à grande ampleur ?
Il faut poursuivre dans ce sens. Chemin faisant, les contacts et les pistes se multiplient mais je sens que j’avance dans la bonne direction. Je sais déjà que je ne suis pas le seul à croire à la possibilité de changements sociétaux de belle ampleur et motorisés par des technologies issues de l’Internet. Les IIUPs ne sont pas des OVNIs (“je veux y croire” en tout cas). Allez, en avant…
C’est dans la jungle du RER que je tombe sur mon étape suivante : j’y reconnais Xavier. Je l’avais rencontré sur recommendation d’un très bon ami à une époque où je m’intéressais au rôle des ingénieurs dans le secteur public. Si je ne me trompe pas, il doit en connaître un rayon sur les innovations dans le secteur public. Pour peu qu’il s’intéresse à l’Internet… Je l’aborde et lui demande ce qu’il devient. Surprise : il dirige justement des recherches sur le knowledge management pour un grand ministère ! Double-surprise, un ministère s’intéresse au knowledge management à tel point qu’il finance des projets de recherche sur le sujet ! Xavier m’accorde donc un bon morceau d’après-midi pour que nous partageions nos passions communes et notre intérêt pour les innovations Internet d’utilité publique. J’y découvre comment les techniques de représentation des connaissances pourraient être utilisées pour formaliser l’expertise métier contenu traditionnellement dans les énomes annexes techniques des plus gros appels d’offres publics. J’imagine le champ des applications : aide au dépouillage des réponses à des appels d’offres complexes, contrôle semi-automatisé de la conformité des livrables des appels d’offres, formation des nouveaux ingénieurs du secteur public, etc. Comme pour de nombreux autres business, les métiers traditionnels de l’Etat peuvent avoir à gagner à mieux gérer leurs connaissances. J’y apprends également l’existence de projets d’universités en ligne ouvertes dont l’un des objectifs est de démocratiser l’accès à la connaissance par la mise en commun de contenus pédagogiques d’intérêt public. L’université de Phoenix, leader privé de l’enseignement en ligne, sera-t-elle un jour concurrencé par des services publics européens d’enseignement en ligne pour ingénieurs par exemple ? De tels projets se préparent mais n’en sont qu’à l’état larvaire semble-t-il. Et, encore une fois, ils semblent s’appuyer davantage sur du bénévolat et l'(in)attention bienveillante de l’Etat que sur une démarche volontaire d’innovation durable et économiquement viable. Comment aller plus loin ?
Il est temps de suivre les pistes repérées précédemment. Comment ça se passe du côté des collectivités locales ?
Alain dirige les projets “nouvelles technologies” d’un conseil général rural . Alain, l’un de mes anciens clients, a un profil rare : c’est un ancien entrepreneur reconverti au secteur public. L’économique, il sait ce que c’est. La techno, ça le fait vibrer. Et le secteur public, il y consacre sa vie professionnelle. Il me confirme immédiatement que ce sont les collectivités territoriales qui sont les plus susceptibles d’être innovantes en matière de nouvelles technologies (comparées à l’Etat). Ceci s’explique notamment parce qu’elles ont une pression (électorale) beaucoup plus immédiate et des enjeux plus concrets à traiter. Cependant, les budgets ne suivent pas forcément les augmentations de responsabilité (et d’effectifs). Pour Alain, les facteurs clefs de succès pour un conseil général qui veut mener à bien des projets numériques sont le fait de pouvoir s’appuyer sur des grosses communes, de savoir gérer des relations multi-partenaires et de savoir faire face à l’usager-client. Alain se prend à rêver avec moi aux départements qui lui semblent avoir les plus beaux challenges à relever (et les plus importants moyens ? ) en matière de nouvelles technos pour mener des innovations d’utilité publique : le 93 et le 59. En administration centrale, c’est peut-être le ministère des finances qui est l’administration la plus intéressante de son point de vue. Mais bon, personnellement, je ne me sens pas vibrer devant une feuille d’impôt fut-elle électronique. OK, c’est utile. Et c’est innovant. Un peu. Un tout petit peu, à mon avis. Mais je suis exigeant en la matière. Alain m’indique quelques références de consultants spécialisés sur son domaine. Mais j’ai déjà renoncé à trouver des consultants porteurs d’innovation. Le métier du conseil consiste trop souvent à limiter au maximum les risques (du consultant et, parfois du client) et à resservir le plus grand nombre de fois les mêmes recettes et ce, le plus cher possible. Le métier du conseil, c’est de comprendre le client, pas de prendre des risques à sa place. Confirmant les indications de Daniel de la FING, Alain me recommande de me raprocher de la Caisse des Dépôts : au croisement de l’économique et des collectivités locales, la CDC doit avoir une vue privilégiée des innovations Internet d’utilité publique auxquelles nous rêvons.
Sur ces bons conseils, je me taille donc un chemin jusqu’à la caisse des dépôts. J’y découvre une équipe dédiée à l’innovation au service des collectivités locales et des usagers des services publics. Ai-je enfin découvert l’eldorado des innovations Internet d’utilité publique ? Peut-être en partie. On y parle investissement raisonné dans de nouvelles offres de services publics économiquement rationnelles voire profitables à long terme. Comme souvent, les premiers sujets explorés ont été les infrastructures : espaces publics numériques pour l’accès du public à l’Internet dans des lieux publics, et depuis quelques années infrastructures réseaux et alternatives aux offres de l'”opérateur historique” (il faudra que je finisse par aller le voir, celui-là aussi…). Mais on parle aussi de service public en ligne personnalisé, de cartable numérique et autres grands projets d’utilité publique. Et les moyens mobilisés dans la Caisse des Dépôts semblent bien réels, au moins en terme de personnel. Bien sûr, la caisse n’a pas une culture d’innovation façon Silicon Valley ! Mais se pourrait-il qu’au sein d’une si vénérable et rhumatisante structure susbiste une petite équipe d’irréductibles innovateurs ? Se pourrait-il que tous ces projets d’innovation réussissent à éviter les écueils des clientélismes politiques et des échéances électorales tout en restant axés sur de véritables enjeux d’utilité publique ? Ce serait tellement bien si c’était vrai… Ce n’est pas ce premier entretien qui me permettra de me faire une idée définitive sur la question. En tout cas, j’ai encore une fois obtenu la confirmation qu’il existe des projets Internet d’utilité publique menés par des acteurs sérieux et y mobilisant des moyens importants en argent et en compétence. Bonne nouvelle pour les collectivités ! Par contre, on est dans le registre du gros projet structurel davantage que dans la bidouille agile et productrice de ruptures sociales et économiques profitables. On est dans le raisonnable et dans le planifié, pourriez-vous me dire : on ne change pas la société avec de la techno ? Quoique, il faut bien la changer avec quelque chose, non ? Ou bien, à tout le moins, les projets les plus innovants menés par la Caisse des Dépôts (cartables numériques, …) sont encore loin d’avoir fait leurs preuves. Et ces preuves ne semblent attendues qu’à long terme. De la Caisse des Dépôts à la startup, il y a une différence, non ? OK.
Bonne pioche avec la caisse des dépôts. Cette étape de ma recherche a été fructueuse en renseignements et en prises de contact. Voila une équipe centrée sur les innovations Internet d’utilité publique, pas de doute, même si l’approche adoptée semble bien loin du social entrepreneurship d’une part, de la garage company d’autre part. Mais il ne faut pas s’en étonner, on reste dans le domaine du financement de projets du secteur public.
Et l’opérateur historique, alors ? Fabien m’a mis en contact avec Pierre. Pierre, chercheur et entrepreneur dans l’âme, connaît par coeur France Telecom pour y travailler depuis longtemps déjà. Pierre m’accueille chaleureusement au centre de recherche de France Telecom et me met immédiatement au parfum : faut pas rêver, c’est pas chez FT qu’on trouvera de l’innovation Internet d’utilité publique. D’ailleurs, d’après lui, la rumeur est exacte : on n’y trouvera pas d’innovation tout court. FT a un beefsteak à défendre et il se passera encore longtemps avant que FT ne se retrouve en situation tellement concurrentielle qu’il sera forcé à innover pour conquérir de nouveaux marchés. Le trait est sans doute un peu forcé mais à peine. Et, bureaucratie faisant, ce n’est pas un environnement propice à l’innovation. Mais alors, pourquoi ces observations ne s’appliqueraient pas également à la caisse des dépôts ? En appliquant mes observations de la caisse des dépôts, et en étant optimiste, on peut au mieux imaginer qu’il existe chez FT quelques écosystèmes de niche internes au sein desquelles susbsitent des équipes mobilisant des moyens importants pour construire et commercialiser des offres de services nouvelles et répondant à des besoins d’acteurs publics ou de véritables attentes sociales ?
Pierre a en tout cas achevé de me décourager à chercher dans l’immédiat des pistes d’IIUPs chez France Telecom. Au contraire, il me donne généreusement de nombreuses pistes pertinentes à explorer dans son carnet d’adresses.
Une de mes anciennes collègues de travail m’avait fait découvrir l’économie de communion. A l’occasion d’une conférence sur ce thème, je rencontre la directrice d’un groupe agro-alimentaire. Celle-ci cherche maintenant à mettre ses compétences managériales et entreprenariales au service d’enjeux d’utilité publique, sur des thématiques de développement durable. Peu familière de l’univers des nouvelles technologies, elle m’invite cependant à rencontre Bernard un business angel qui cherche à répondre à des problématiques d’utilité publique par les outils du financement et de l’accompagnement de petites entreprises. Celui-ci évoque avec moi quelques projets sur lesquels il travaille. Il se révèle l’une des rares personnes rencontrées qui se situe à l’exact croisement des démarches d’innovation et de réponse à des enjeux d’utilité publique, plus particulièrement environnementales. Il me prouve, si cela était nécessaire, que les acteurs du secteur public sont bien loin d’avoir le monopole des innovations d’utilité publique. Nous évoquons ce en quoi l’Internet pourrait être utile pour de tels projets : du plus utopique avec la commercialisation de services en lignes de médiation appliqués au développement local jusqu’au plus prosaïque avec celle de services en ligne d’information sur la qualité de l’environnement dans les grandes villes françaises. Bernard semble un pont rare entre pur entreprenariat et économie sociale. Il serait sans doute une aide précieuse pour les social entrepreneurs qui émergeront un jour sur les marchés français.
Je ne peux terminer cette expédition estivale sans prendre le temps d’appeler mon pote Jean-Paul. Jean-Paul, ancien directeur d’association est aujoud’hui consultant Internet expérimenté auprès de collectivités locales et du tiers secteur. Il m’explique pourquoi son projet de création d’entreprise d’insertion par les nouvelles technologies n’a jamais pu voir le jour : l’incompétence professionnelle d’institutionnels de l’insertion pour l’économique y est pour quelque chose. Le dégoût et la méfiance des “vieux roudoudous du monde associatif” n’y sont pas pour rien. Alors, tout espoir est-il perdu de voir un jour des innovations privées répondant à des enjeux d’utilité publique à l’aide des technologies Internet ? Jean-Paul pense qu’aujourd’hui, les seuls acteurs qui peuvent prétendre à faire du sérieux dans le domaine, ce sont les équipes d’ingénierie des télécommunications des grosses ONG internationales, quoique ce ne soit certes pas dans une démarche entreprenariale. Alors, où verra-t-on de vraies IIUP demain ? Il hésite un instant et me confie : l’enjeu d’utilité publique auxquelles de telles innovations pourraient répondre de la manière la plus profitable, c’est le financement de micro-projets associatifs. Oh-oh ! Voila qui m’inspire… Il faudra que je (lui et) vous présente bientôt le projet que cette idée m’inspire.
Cette expédition a pris fin dans le courant de l’été : il fallait bien que je parte véritablement en vacances à un moment donné, non ?! Récapitulons les questions que je me posais initialement et mes conclusions à ce stade de mes recherches :
- les innovations Internet d’utilité publique ne sont plus totalement terra incognita puisque je suis revenu vivant de cette expédition pour vous en parler
- Peut-on répondre durablement à des enjeux d’utilité publique avec l’Internet ? Je n’en ai pas acquis la preuve mais nous sommes nombreux à y croire, alors pourquoi pas.
- Les IIUPs, est-ce que ça existe vraiment ? est-ce un OVNI ? Peut-on faire de l’innovation Internet d’utilité publique à grande échelle et avec des moyens vraiment conséquents ? Ces entretiens m’ont permis de rencontrer plusieurs personnes affirmant qu’ils ont vu voire rencontré des IIUPs. Pour certains, il s’agit même de sujets de travail sur lesquels sont mobilisés des moyens significatifs dans quelques grandes organisations.
- Qui s’est déjà attelé à de tels projets ? La carte ci-dessous récapitule les principaux acteurs que j’ai pu répérer et/ou rencontrer jusqu’ici. Il me faudra un jour positionner sur cette carte des acteurs tels que le Réseau Idéal, 6nergies, Ilog, Sofrecom, l’UNIT Consortium, Sopinspace, la DATAR, Ashoka, Navidis, Novethic et d’autres…
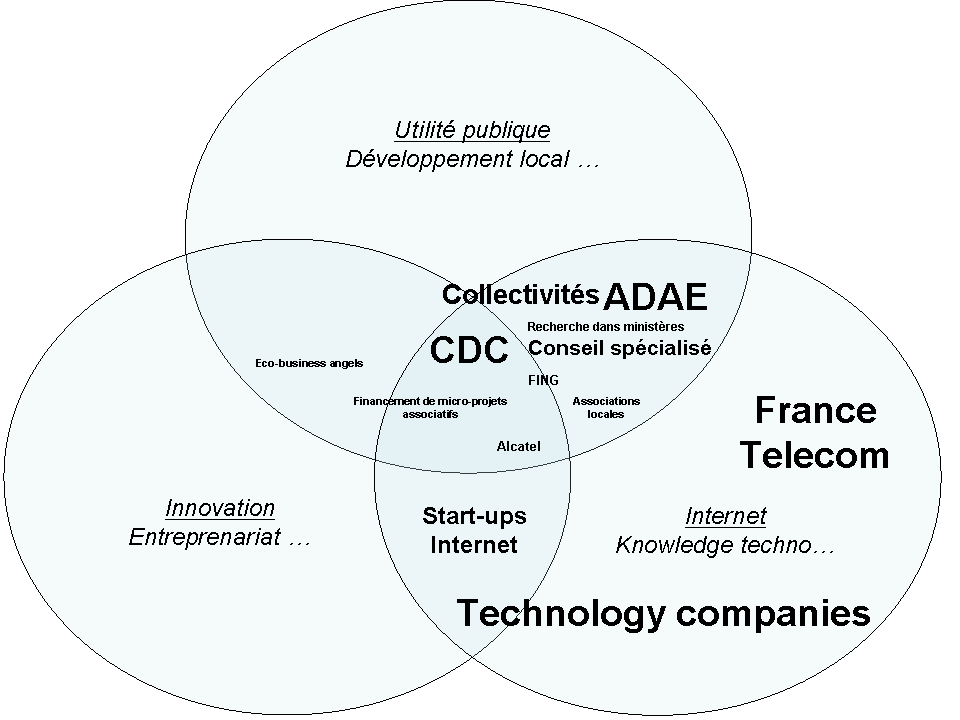
Malheureusement, l’été a été trop court pour explorer toutes les pistes qui se sont offertes à moi. Et, reprise oblige, j’ai moins de temps pour explorer ces pistes par des entretiens face-à-face (sauf à déjeuner ensemble, bien sûr). Alors je me tourne également vers vous pour m’aider à affiner ces idées. Comment croiser, en France, utilité publique, entreprenariat et nouvelles technologies ? Ces ingrédients peuvent-ils prendre en mayonnaise ? Où sont les grands Chefs cuistot en la matière ? J’aimerais savoir ce que tout cela vous inspire. Comment voyez-vous les choses ? Qui peut me donner plus de tuyaux à ce sujet ? Comment poursuivre cette exploration et dans quelles directions ?